Accueil > FICTIONS DU MONDE | RÉCITS > Anticipations > anticipations #25 | Nuits de Walpurgis
anticipations #25 | Nuits de Walpurgis
samedi 2 mai 2015
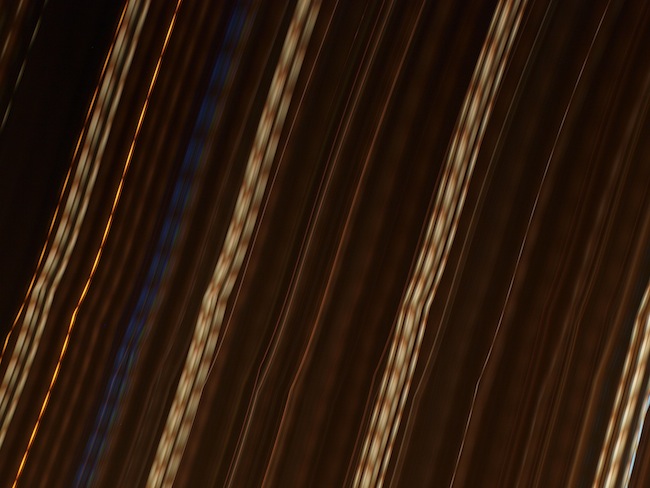
Note du 2 mai 2015. J’ai oublié, hier, la nuit du Walpurgis. J’en reste inconsolable. Ainsi me faudra-t-il attendre un an pour brûler cette nuit et l’inconsolé de ces jours ?
Du moins déposé-je ici cette nuit du Walpurgis, celle de 2009, lointaine et proche d’autres brûlures, d’autres consolations.
Ce premier mai 2013, je dépose ici ce texte, issu de mes anticipations, écrit n’importe quel autre jour que le premier mai, au printemps 2009, en souvenir de Verlaine (qui avait écrit sa nuit de Walpurgis en souvenir de Gœthe) - premier mai, nuit du Walpurgis, nuit du feu autour duquel danser le feu, vingt-cinquième récit dans la série qui en comporte cinquante-et-un, soit le pli du livre, ou presque.
Ces prochains jours, reprises de mes nouvelles, d’autres nuits anciennes à inventer, mes anticipations comme l’élaboration interminable et progressive d’un projet d’avenir très lointain, qui serait perdu.
C’est un bruit de machinerie qui s’éteint et laisse dans son sillage comme une trace de son extinction, au ralenti. Les lumières s’éteignent, toutes en même temps, avec la télévision, les ordinateurs, les réveils, les aspirateurs, les radios – et nous, on est comme arrêtés dans notre élan, on s’arrête soudain de marcher, ou de manger, ou de laver : et le geste, le pied lancé, la fourchette tendue, l’assiette tenue sous l’eau, est coupé, comme si ce qui se débranchait avec les appareils nous concernait, comme si nous appartenions machinalement à ce monde là, nous aussi, pour un temps qui nous débranchait, ou qui se débranchait de nous.
C’était le premier soir, mais les autres soirs également, on reprendrait cette absurde posture – cette suspension du corps. Cela ne durait pas : le corps reprenait ensuite rapidement ses mouvements ; la coupure, elle, durerait toute la nuit. Le premier soir, on vérifiera que chez le voisin aussi la coupure d’électricité l’avait concerné, et on comprendra que tout l’immeuble est touché, que toute la rue même, tout le quartier. Le lendemain, on apprendra que plus que la ville, le pays avait été touché, et le continent (on avait cru savoir qu’il s’agissait d’une panne, dans un pays proche, au cœur d’une centrale qui, régulant l’ensemble du système, avait été responsable de la paralysie).
La nuit durant, on avait cherché des lampes de poche, et c’était devenu un jeu ; après avoir calmé l’angoisse des enfants, on avait allumé des bougies, on s’était couchés plus tôt, persuadés que la reprise du courant allait être imminente, que la coupure ne durerait pas. Elle ne dura pas : elle ne durerait jamais plus longtemps que le lendemain.
Au matin, à l’heure où habituellement les éclairages municipaux s’éteignent, au moment où le soleil est sur le point de se lever, le bruit de machine reprenait là où la veille au soir il avait cessé – le ralenti s’accélérait et on pouvait entendre de nouveau le ronronnement des réfrigérateurs, les cris dans les téléviseurs et les radios ; sur les réveils, on voyait clignoter les zéros, signe que le temps reprenait pied lui aussi dans le réel, qui affichait le commencement un peu absurde du premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir.
Au crépuscule, c’était une mauvaise farce qui reprenait – à peine se disait-on que la veille à la même heure il avait fallu sortir les lampes que la coupure se faisait, le même bruit arrêté des machines. La journée, on n’avait parlé que de cela, avec gravité, comme d’un accident d’avion. Mais deux vols d’avion qui se succèdent dans la mer, on ne l’avait jamais vu. On était un peu plus rodé pour faire face, mais l’insolite de la veille laissait place à un vague agacement – et déjà, on pensait au lendemain, quand on réclamerait les coupables. On les trouva.
C’était cette fois une autre centrale, censée réguler la surchauffe due à la reprise brutale du matin qui n’avait pas tenu. Concours de circonstances malheureux. Toutes les dispositions étaient prises pour que cela ne se reproduise pas une troisième fois de suite.
Le soir, bien sûr, la coupure se reproduisit, ponctuelle, une troisième fois de suite. Et le quatrième soir aussi. Toute la semaine qui suivit, et la semaine d’après. On s’organisa. Il avait bien fallu s’organiser. On essaya d’abord d’installer des batteries d’énergie secondaire, pour coupler l’acheminement de l’électricité localement, en privilégiant les grandes villes.
Mais ces batteries cessaient de fonctionner également le soir venu, à l’heure dite.
On ne trouva pas d’autres moyens que de subir ces coupures, une nuit après l’autre. Sur toutes les grandes villes, c’étaient de nouvelles habitudes qui se prenaient rapidement, des socialisations parfois profondes, souvent violentes – la loi dans les rues laissées à l’arbitraire de la nuit la plus opaque était devenue aveugle. Le noir qui s’établissait garantissait une impunité presque totale aux bandes lâchées dans les villes, libérées de la lumière.
Le couvre-feu imposé par la coupure nécessitait de rentrer avant elle, sous peine de mort. Certains choisissaient de s’affranchir des appareils électriques et de toute lumière artificielle pendant le jour aussi, soit qu’ils étaient persuadés que la coupure s’étendrait bientôt à la journée, soit pour n’avoir pas à faire face à ce changement absurde de mode de vie, d’un jour sur la nuit. Ils n’étaient pas si nombreux, à vivre de bougies, et à jeter par la fenêtre les écrans, les lampes.
Tous les soirs, nuits de Walpurgis mal éclairées par le feu, la vie changeait de tonalité, gagnait en intensité pour ceux qui sortaient au dehors voir le monde s’affoler, ou s’éteignait totalement pour ceux qui préféraient s’enfermer et dormir le temps que durerait la nuit, et avec elle la coupure. Ce qu’on perdait avec le souvenir de la nuit éclairée, c’était davantage que le confort, l’idée qu’on s’était faite de la civilisation : ce qu’on regrettait, c’était bien plus que le jour artificiel du jour. On marchait dans les rues et on voyait les étoiles, celles qu’on ne voyait que rarement, autrefois, par temps très clair.
On aurait voulu n’avoir jamais à avancer sous leurs seules pâleurs – et sans trop savoir pourquoi, en un sens, on savait qu’on était privilégiés. Le monde s’enfonçait chaque soir dans ses ténèbres, et on y prenait part.
