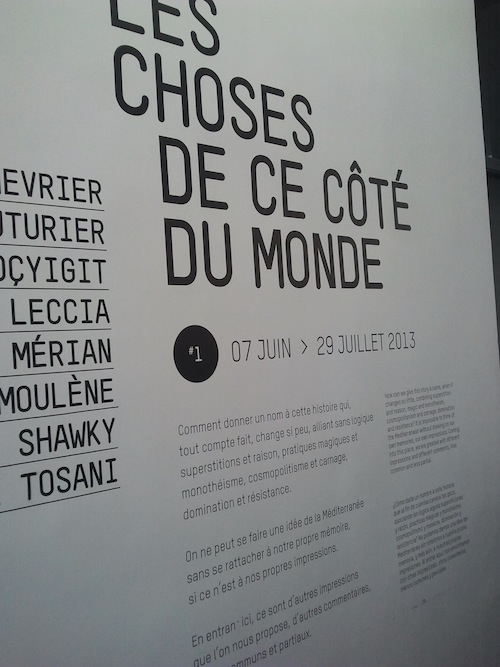Accueil > PHOTOS & VIDÉOS | IMAGES > PHOTOGRAPHIES | fixer les vertiges > image fiction | dans le jour, ce qu’on emporte avec soi
image fiction | dans le jour, ce qu’on emporte avec soi
mardi 23 juillet 2013
image fiction, la ville et les rêves – dialogue avec françois bon, prolongé tard dans la nuit…

dès l’aube l’image comme la persistance d’un vieux rêve que tu ferais toute la vie (ce matin c’était la première fois : et déjà tu savais que ce serait toute ta vie, ce rêve), le jour comme un fort levé au devant des villes comme les villes en possédaient avant, au temps où on pouvait entrer par la mer (maintenant, la mer est inoffensive), et ce fort jadis armé de pied en cap, éventré, et tu te lèves.

sur le miroir, rien que ton visage : il a cette forme de ton corps pris de très haut, tu es seul devant lui mais c’est comme de la foule qui frôle à ton passage ce qui t’entoure, toi tu essaies de regarder tes yeux, mais à leur hauteur, quelque chose comme l’appareil qui sert à regarder ces yeux l’empêche : de cela aussi, tu es tout entier bâti, et c’est dans ce regard plongeant que tu iras, ensuite.

quand tu t’éloignes du miroir, tu ne vois pas ce qui demeure sur elle : la foule, qui remue noir et loin, s’éparpille à la place de ton visage, remplace ton visage, ignore en le piétinant ton visage ; tu es aussi, tout entier, d’eux, enveloppé.

dans les tâches insensées de ce monde, parfois tu t’arrêtes, tu regardes : il y a un peu de ville au loin, elle pourrait être possible ; il y a en travers, comme entre elle et toi, ton corps qui danse l’immobilité de lui-même, armé d’un disque qui pourrait servir si on savait comment le faire revenir, (et les chiens lâchés sur toi, quelles parts de toi impossibles à enterrer ?) mais ton corps préfère mimer le mouvement du mouvement au pied des chiens, dans le cri arrêté des chiens, et toi, dans ce cri longtemps, et dans le miracle de la ville dansée aussi, parce que c’est ainsi seulement qu’elle le peut, tu regardes la ville.

à l’opposé, la mer comme jamais (tu es l’espace intermédiaire entre la ville et la mer, c’est ta place sur cette terre, tu l’as acceptée et tu sais les lois qui t’y assignent maintenant), quand tu as fini de regarder la ville, c’est vers elle que tu plonges ton regard, ton corps ancré, et ton visage quelque part aussi profondément que possible en toi : parce que la mer est l’opposé de la ville, et ce qui fait de la ville quelque chose comme l’opposé de la mer, et la mer, un envers de ville : l’horizon renversé, la foule absente, les silences et les heurts brisés, la mer est une ville dépouillée de ville : c’est donc entre que tu te tiens : il y a des jetées qui formulent l’allégorie d’un mystère, comme des passerelles qui franchissent, mais qui semblent tendues seulement pour qu’on se précipite dans le vide, des passerelles comme des lignes que tu as lancées et forgées et tendues pour qu’elles soient capables de supporter le poids et le mouvement dansé des mots que tu jetteras sur elles.

à gauche, ton visage regarde la terre : elle est là, toujours là, et tes yeux posés sur elle la font exister chaque instant davantage : la preuve, elle continue d’être là tandis que tu la regardes.

en face, c’est ton visage, celui que tu ne sais plus voir parce qu’il t’appartient : tu ne sais par où il commence, alors tu ne le vois plus, tu le contrefais souvent, et souvent, c’est un autre que tu regardes à travers lui, le visage que tu possèdes la nuit tard des rêves, dans le jour c’est lui qui te possède, tu te dis (souvent) : c’est peut-être mieux ainsi ; et parfois tu poses les mains sur lui et le déchire intérieurement, cela forme sur l’écran des phrases entières, et tu appelles cela, faute de mieux, écrire.

à droite, c’est l’horizon ; on y a planté une poubelle, elle est vide, elle est pleine, comment savoir, il faudrait plonger la main en elle, et tu n’oses pas, tu regardes l’horizon buté sur une poubelle noire, et plus loin pourtant le ciel se confond avec de la mer, est-ce l’inverse ?

le fort toujours dressé comme d’un désir la possibilité de sa fin, et la ville après le port, loin, sous les maisons tous les drames et les cris et les corps qui vont entre les drames et les cris pour tâcher toute la vie de les apaiser, tu sais que tu es une part d’eux, puisque cette ville est chaque jour ton désir dressé comme la fin possible du jour, sa tâche recommencée.

parfois, un bateau, minuscule, transitoire, s’échappe de tes pensées : là où il va tu refuses de le savoir ; la terre roule, tu l’as appris enfant, et ses bords laissent s’écouler le vide et les monstres, le bateau qui voudrait découvrir le monde, inventer des continents, tu sais pourtant que c’est ta part la plus précieuse, à lui tu lui accordes la force et la tendresse : c’est dans les cales de ces minuscules bateaux que tu as déposé de l’eau pour la soif, et des cordes pour le vent, qu’il t’emporte (tu penses : qu’il m’emporte jusqu’où je ne puisse plus avoir pied).

quand tu te couches, tu as écrit sur l’écran les pages que tu devais au jour, ce sont des mots, ça compte si peu dans la marche forcée du réel, au moins tu les auras arrachés à une part de toi inconnue, à une part énigmatique de ce jour, à une part de folie que tu as voulu accepter pour la traverser, à la part précieuse de l’autre à laquelle tu t’adresses, en cet endroit même où il l’ignore aussi, et qu’il reconnaît en partage : c’est un peu flou, tout cela, si tu écris les yeux vagues, ce n’est pas pour le flou, ce n’est pas pour faire le point, c’est pour mesurer la distance entre le flou et le point, et pour la distance qui rend le monde possible et l’appartenance aux frères qui de ce côté du monde, disent : nous sommes de l’autre côté du monde, et nous y allons chaque jour rien qu’avec la nuit, à mains nues.