Accueil > RECHERCHES | ARTICLES & COMMUNICATIONS > Faire écran à l’histoire. L’écriture intermédiale de Warlikowski
Faire écran à l’histoire. L’écriture intermédiale de Warlikowski
Narrativités et intermédialités sur la scène contemporaine
jeudi 5 août 2021
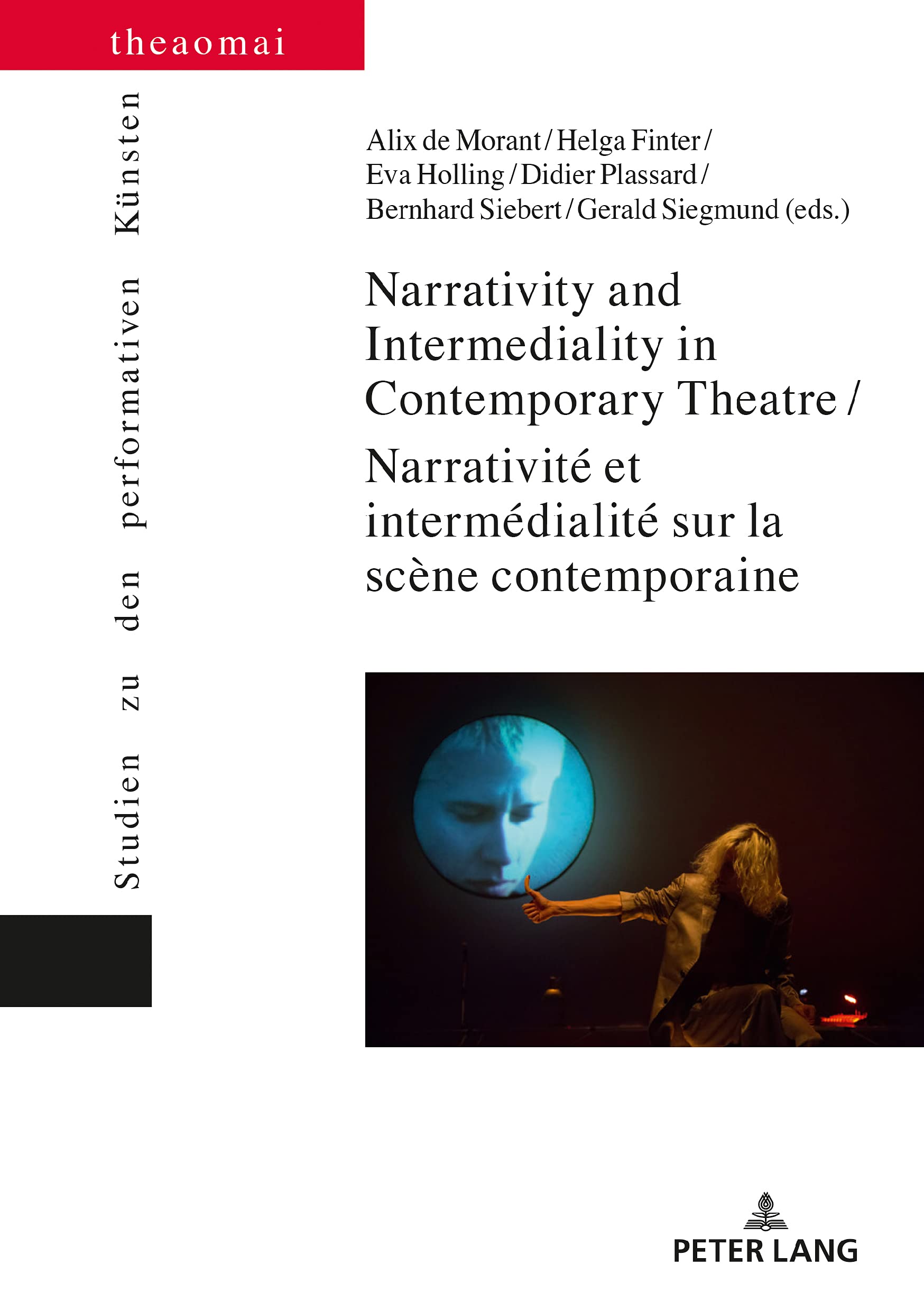
Article publié dans Narrativités et intermédialités sur la scène contemporaine,
Sous la direction d’Alix de Morant, Helga Finter, Eva Holling, Didier Plassard, Gerald Siegmund et Bernhard Siebert
Lausanne, Eds. Peter Lang, août 2021.
Il est issu de la communication proposé au colloque « Narrativité et intermédialité », organisé par Gérald Siegmund et Didier Plassard à l’Université Paul-Valéry, du 6 au 9 novembre 2016.).
Résumé
L’usage par le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski des dispositifs intermédiés depuis 2009 témoigne d’un rapport singulier à l’histoire : c’est parce que l’Histoire fait écran à notre émancipation que les écrans se dressent sur le plateau pour dresser la possibilité d’une nouvelle manière de raconter afin de mieux se réapproprier notre Histoire. Ce théâtre voudrait inventer les territoires neufs où le corps inventerait son identité, en lutte contre celle que lui imposent les pouvoirs : le corps de l’acteur sur scène et son corps spectral sur les écrans lèvent le dialogue d’une autre histoire, qui venge l’Histoire aliénante de notre présent pour raconter celle d’un affranchissement : la contre-histoire des identités réinventées.
Il faudrait commencer par la fin — ou plutôt dans la fin : puisque c’est depuis la fin que se racontent les histoires, dans la fin que les narrations trouvent point de fuite et lignes de sorcières [1] , se pensent, s’inventent et se renouvellent.
Ce serait dans la fin donc, que l’on pourrait nommer notre histoire, cette époque où nous vivons : la fin non comme terme, mais intervalle, intermédiaire, écart suspendu à l’horizon indéchiffrable de nous-mêmes. Notre temps : celui de la crise qui consiste justement, pour Antonio Gramsci, dans le fait que l’ancien monde meurt et que le nouveau ne peut pas naître : pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres [2] ». Interrègne – intermédian du temps : monde qui se montre comme tel, dans l’écart de l’origine perdue et de l’horizon qui recule – entre-deux sans masque, monstres, que l’art aurait l’antique tâche de montrer.
Dans cet espace de seuil, ce qui finit pourrait inaugurer d’autres récits émancipateurs, émancipés de la fin. Espace de reconquête esthétique contre les replis politiques. Mais comment écrire l’histoire, et par quelles histoires ?
On jette un regard dans le flux et le reflux de l’histoire qui passe sur les écrans en temps réel, sur les bandes passantes des informations continues — comme passait autrefois le cheval du WeltGeist sous les fenêtres de Hegel : car, écrivait Hegel à son ami Niethammer, « J’ai vu l’Empereur, – cette âme du monde (ce WeltGeist) — sortir de la ville pour aller en reconnaissance ; c’est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s’étend sur le monde et le domine [3] . » Qui marquera ce point nous permettant de reprendre possession de notre Histoire en retrouvant les termes de l’histoire ? De la fenêtre d’Hegel aux nôtres, le monde est devenu cet écran même : écran qu’on ouvre et qu’on ferme désormais à même nos ordinateurs. Et devant ces fenêtres qu’on ouvre en surfant en ligne, demeure suspendue l’antique question politique : que faire ? Traverser, ou regarder ? Ou projeter, ou se projeter.
Un geste s’élabore qui voudrait tout à la fois nommer cette histoire, la saisir, la défier, la défigurer, la traverser : comme pour reprendre possession de notre temps, au-delà ou malgré ce qui fait écran à notre Histoire. Or, cette histoire, il est d’autant plus périlleux et urgent de la nommer qu’elle semble faire écho aux pires de notre passé récent. Aux retours des refoulés nationalistes, ferment des fascismes, qui se dressent partout en Europe, répond singulièrement une radicalisation neuve des formes théâtrales, où les enjeux de représentations cèdent le pas sur des puissances davantage performatives, ou en tous cas cherchant un face à face plus brutal avec un public, une histoire, ses propres formes. Ces lignes de radicalité qui convergent, peut-on les saisir ensemble ? Et interroger l’une par l’autre ?
Warlikowski naît au théâtre à la fin du XXe s. Après des études de philosophie et d’histoire à Cracovie, il entre à l’École nationale supérieure de théâtre Ludwik Solski de Cracovie. Assistant de Krystian Lupa notamment, il monte d’abord des spectacles à partir de textes dramatiques : Shakespeare en 1994 avec Le Marchand de Venise ; Koltès en 1995 avec Roberto Zucco, Sophocle en 1997 avec Électre. Il multiplie les allers-retours entre tragiques classiques et contemporains : Shakespeare et Euripide ; Koltès et Sarah Kane…, produisant sur scène une esthétique du choc dans l’unité de la fable. À partir de 2009 avec (A) pollonia (d’après Eurpide, Eschyle, Hanna Krall, Jonathan Littel, et J.M. Coetzee), Warlikowski opère un tournant radical. Refusant désormais de monter des pièces, préférant écrire des spectacles depuis le montage de textes souvent non dramatiques, Warlikowski multiplie les mises en scène monumentales qui ne reculent pas devant les scandales dramaturgiques — par les courts-circuits qu’ils proposent — et politiques — en travaillant avec acharnement à rappeler la mémoire douloureuse et oublieuse de son pays.
En Pologne, le 3 octobre 2016 tombait un lundi noir [4] . Des femmes manifestaient en grand deuil contre un projet de loi visant à revenir sur la législation en matière d’avortement. Quand un pouvoir revient à rebours de l’histoire, c’est toujours sur les corps qu’il exerce d’abord et avant tout son pouvoir, ou sa puissance [5].
La Pologne actuelle et ses politiques rétrogrades pourraient sembler l’expérience des fins — cet espace intermédiaire des histoires et des troubles dont on peine à deviner les issues. Là travaille le metteur en scène Krzysztof Warlikowski, qui tâche de produire les récits neufs capables de dire le présent. Et nul hasard si l’enjeu de l’émancipation des corps, la question de l’invention des identités, l’obsession de lier la spiritualité à la conduite de son corps et de ses sexualités hantent la scène warlikowskienne — comme une hantise, le retour d’une histoire qui ne passe pas, mais cherche à frayer, spectre qui se diffuse pour s’inventer comme une Contre-Histoire capable de venger le passé. Et nul hasard si, dans ce théâtre, la question de ce passage — de ce qui passe entre deux lieux, deux identités, deux corps, deux temps —, soit l’enjeu de l’intermédiaire, passe depuis quelques années par la composition plastique et l’usage d’écrans : par une écriture intermédiale qui dialectise le rapport de l’écriture aux corps par celle de l’image projetée.
C’est pourquoi pour commencer, il faut s’arrimer à la fin, et s’en dégager. En finir avec une certaine manière de raconter — la ligne orientée et unique, la causalité comme antériorité, la finalité comme destin, la trajectoire comme exemplaire —, pour raconter d’une autre manière. Une manière plurielle, composite, diffuse, impalpable, perplexe peut-être, inquiète en tous cas, hostile surtout aux formes mortes du récit et au monde qui s’en accommode, mais travaillant dans la syntaxe même de notre monde pour le blesser en son cœur même, multiplicité, flux, synchronicité, à tâtons, et, dans le non-savoir de sa propre ligner. Se situer en son présent même, produire ses points d’appui successifs : ce serait peut-être quelques-uns des grands aspects du récit de la scène de Warlikowski. Et en tout, ce mot d’ordre : élaborer du présent, s’émanciper ici et maintenant. Prendre appui sur ce qui est là et trouver les forces pour s’en échapper, ce serait là créer l’histoire depuis sa fin.
Ainsi en est-il du spectacle Koniec — en polonais, La Fin, ou Fin —, créé en septembre 2010, et présenté en février 2011 à l’Odéon. Quand le spectacle de La Fin commence, la scène est vide, ou plutôt vidée. À cour et à jardin, des espaces ouvrent sur un dehors caché par des cloisons secrètes, mais visibles, derrière les parois de verre. Soudain, une jeune femme surgit du parterre pour se hisser sur le plateau, et danse. C’est Baba, le personnage de Nickel Stuff, tiré du scénario de Bernard-Marie Koltès [6]. Dans le texte de Koltès, qui raconte l’ascension du danseur Baba dans un club de New Hork, ce jeune garçon est noir ; intuition sensible de Warlikowski de donner ce rôle à une jeune fille qui ressemble à un garçon aux longs cheveux décolorés. Émanciper le théâtre de ses corps hanté par l’écriture, telle est en partie la tâche de Warlikowski. Chez Koltès, le film devait s’ouvrir sur Baba dansant, mais en gros plan : de la danse, on ne verrait à l’écran que le visage, l’intense concentration, l’effort physique exposé à son paroxysme. Sur la scène du théâtre de l’Odéon, Baba danse d’abord, immobile, les pieds ancrés sur le sol — elle est soudain filmée, sous l’épaisseur d’une lourde musique, et son image projetée simultanément sur un écran gigantesque dressée en fond de scène. Mais est-ce simultanément ? L’image du corps est peu à peu déformée, ralentie ou accélérée, surexposée par la lumière pourtant légère sur le plateau. Le vidéaste est à vue, il tourne autour de Baba, danse avec l’actrice, presque. Ce vidéaste est peut-être l’autre danseur du texte de Koltès, Tony, ou peut-être le dramaturge lui-même, le lecteur aussi qui tente de cerner les contours d’une danse et le secret d’un corps qui cherche par là à s’émanciper de son destin. La danse dure, les images prolongent ce corps ; c’est un spectre, littéralement : spectre de chair sur le plateau et dont la nudité aveugle, ébloui par surcroit de lumière ; et spectre à l’écran dont la matière brute vibre et danse avec le corps véritable. Une lumière diffuse fait sortir ce corps de ses propres contours, l’élargit sur tout l’espace du théâtre, et va jouer, en persistance rétinienne chez le spectateur bien au-delà de cette séquence. C’est un corps qui s’invente sur la chair du corps réel, le théâtre et son double, tandis que passe l’Histoire où on voudrait nous faire croire que les identités sont des origines, et ces origines des héritages sur lesquels pèsent le poids des dettes.
C’est la première image de La Fin. Le premier corps, le premier écran, le premier récit. Dans cette image qui met à nu la chair vive d’un corps indistinct, fuyant, et aussi, au sens liturgique, glorieux, une loi se cristallise, une sorte de rapport au monde situé dans cette intermédiaire de l’histoire à la conjonction de l’esthétique et du politique du théâtre de Krzysztof Warlikowski.
Il n’y a pas d’histoire dans ce spectacle, mais un métissage des récits de Bernard-Marie Koltès [7], de Franz Kafka [8], récit de John Maxwell Coetzee [9] enfin restitué pour figurer le pli dialectique de Koltès et de Kafka : récits d’un corps qui veut passer, voudrait réclamer le passage d’une identité à une autre. Pas d’autre fable que ces multiplicités qui jouent par échos les uns aux autres et donc chacun est l’écran de l’autre, le paravent et le reflet. Reste une question : se trouve-t-on face à ces formes dites postddramatiques d’où le sens s’est absenté et nous laisserait perplexes, désarmés face au monde, et donc complices de l’ordre stérile de notre temps [10] ? Ou nous donne-t-il des armes pour en retour en reprendre possession ?
Depuis 2009, l’art scénique de Warlikowski a donc pris un tournant majeur et paradoxal. C’est en « fuyant le théâtre [11] » qu’il s’est donné les moyens de renouveler son théâtre. Depuis (A) pollonia, l’artiste polonais a en effet largement bouleversé sa syntaxe dramaturgique pour emprunter aux arts visuels, cinématographiques et plastiques des forces neuves dans le but avoué d’attaquer une façon pour lui révolue de faire du théâtre — mais c’est aussi en s’accompagnant d’un dramaturge, Piotr Gruszczyński, qui a profondément bouleversé aussi son rapport même à la dramaturgie.
Avant 2009 Warlikowski travaillait déjà la matière visuelle et sonore avec précision, densité — la surface du théâtre pouvait recueillir des images projetées (comme dans Purifié, en 2002 déjà) : mais l’enjeu spectaculaire portait davantage sur un rapport brutal avec les corps des acteurs et la relation avec le public, sur une direction d’acteurs dont la matière ne semblait qu’une surface d’appui, une enveloppe, et pas justement ce qu’il devient à partir de 2009, l’écriture même, l’élément du drame, la langue et son énoncé. À partir d’(A) pollonia, le metteur en scène se saisit du texte comme une matière et œuvre à sa lente réinvention, dans un travail de montage incessant et problématique, perplexe quant à son sens certes, mais traversée d’une certitude : celle de se dégager du sens hérité, et qui appellerait à reprendre possession de son corps et de son histoire. Récit ? Machine a-signifiante plutôt, le récit donné par le texte ne vaut plus que comme intensité, branchement à une machinerie plus complexe. C’est là que l’écran a sa place et joue son rôle : c’est l’espace d’une articulation, d’une relocalisation pour reprendre le terme de Yannick Butel [12].
Les histoires que raconte Warlikowski sont désormais à la fois plus indistinctes et plus multiples : elles dessinent toutes le mouvement d’une échappée hors du théâtre, mais par le théâtre. Car ce sont des dizaines d’histoires que racontent ces spectacles, et c’est aussi une seule : celle de l’émancipation des corps et des identités que portent singulièrement, mais exemplairement les contours indistincts de Baba, ce corps de Koniec qui inaugure dans cette fin une nouvelle histoire, et une manière nouvelle d’en raconter.
La volonté de Warlikowski d’adosser ses spectacles à un matériau composite de textes en le saturant de vidéos (tournés en direct) tend à rendre plastique le dispositif scénique. Dans La Plasticité au soir de l’écriture [13] , Catherine Malabou montre combien la pensée contemporaine semble passer d’un régime de l’écriture ou du graphème, à un paradigme de la plasticité. Ce graphe peut cependant demeurer, en tant que tel, comme trace, c’est-à-dire comme sillage, disparition, spectre diffus, apparition qui ne se distingue pas d’une disparition.
Ce passage de Warlikowski d’une syntaxe scénique de l’écriture à une syntaxe de la plasticité l’a aussi conduit depuis 2009 à briser singulièrement un certain rapport à la représentation telle qu’il avait pu la concevoir auparavant, tout en doublant ce rapport d’une distance plus grande quand les écrans projettent des images sans rapport, semble-t-il, avec ce qui se déroule sur le plateau…
Ce qui passe sur le plateau est une dialectique infinie entre scène et écran, dialectique entre ce qui passe, ce qui s’éloigne à l’écran, ce qui demeure en persistance rétinienne et le présent, entre ces deux présents, ces deux présences des corps à l’écran et des corps sur le plateau, et ce qui passe, ou ce qui va venir, entre des régimes de présence qui luttent et frottent l’un à l’autre ; dialectique intérieure ainsi : « Je ne sais pas si avec le temps, je ne me détourne pas de ces feux sacrés dont je brûlais durant ces cinq, six dernières années », disait-il en 2007 déjà ; avant d’ajouter : « le théâtre appartient aux jeunes metteurs en scène, à ceux qui l’abordent pleins d’impétuosité et dont l’énergie emmagasinée s’exprime dans les premières réalisations. L’homme mûr commence un peu plus à calculer, à aller dans le sens de la réflexion, à mettre de l’ordre dans ses pensées [14]. »
L’Écran serait ainsi l’espace d’un deuil de l’œuvre elle-même, d’un sacrifice (mot qui revient tant de fois dans les propos du metteur en scène) — et dans ce rapport réflexif qu’il entretient avec sa propre œuvre —, l’usage des écrans aurait aussi pour rôle de jouer l’articulation de la pensée et des corps, du propos avec sa perspective.
Car ce virage est contemporain du souci de Warlikowski de dialoguer plus férocement encore avec son temps, et notamment avec l’Europe de notre extrême présent, où l’ultralibéralisme s’associe à l’ultraconservatisme moral, où l’enjeu des identités est prétexte à un repli vers l’origine qui tend à faire oublier les racines cosmopolites du continent — où l’atomisation des individus jetés dans la compétition mondiale (économique, spirituelle, érotique…) les dressent les uns contre les autres.
En Pologne, ce contexte se nourrit d’une violence d’État tournée contre des minorités, religieuses ou sexuelles. Or, cet État tend partout à imposer sa domination, notamment au théâtre : qu’on songe aux débats entourant le refus de Krystian Lupa de poursuivre les répétitions du Procès de Kafka pour protester contre la nomination d’un nouveau directeur au théâtre Polski de Wroclaw — et si Lupa finira par monter ce spectacle, c’est aussi en le nourrissant d’une farouche colère politique contre le contexte polonais [15] . C’est aussi pour répondre à ces violences que Warlikowski conçoit son nouveau lieu de création, le Nowy Teatr, comme un espace artistique et politique, marginal et essentiel, lieu de rencontres, centre d’art et d’échange, sorte de Baracke sur le modèle inventé pour le Deutsches Theater à Berlin par Ostermeier dans les années 1990, avant son institutionnalisation — ou peut-être plus idéalement inspirée du projet d’Andy Warhol et de sa Factory : espace d’inventions et d’émancipation des identités, où les leçons de Grotowski sur la sanctification du corps de l’acteur, celles de Kantor sur le face à face libre à livrer devant la mort, rejoignent des aspirations matérialistes devant l’urgence étouffante de l’époque.
Il faudrait lier les deux virages des radicalités pour voir comment l’usage des écrans par Warlikowski tend aussi à nommer un certain rapport politique au présent — où l’image, le double fond de l’écran, le travail plastique de la projection tendent à travailler cette question des corps inventés, des fictions qui voudraient trouver les lieux de leur émancipation à rebours des déterminismes, ou par effraction ou par sublimation : s’inventer des origines. C’est là l’objet de l’écran : sa surface d’intensification qui serait moins un support qu’une profondeur politique.
Dans le rapport de force que Warlikowski souhaite instaurer au sein de son théâtre avec notre Histoire, il semblerait que Warlikowski n’utilise pas les écrans pour peupler son théâtre d’un ailleurs, ou faire signe vers un dehors : il convoque par les écrans un récit de surcroit qui viendra dialectiser le propos mis en scène pour le situer.
Metteur en scène de la dialectique (Georges Banu écrivait qu’il était « la dialectique de la thèse Grotowski et de l’antithèse Lupa [16] »), et artiste de l’écorchure, de l’écorchement, Warlikowski fait de l’écran l’espace où se creuse le plateau, où se révèlent les fantasmes aussi : une sorte d’intériorité du théâtre qui se libèrerait du théâtre et libèrerait son théâtre.
Au début de Le Château de Barbe-Bleue/La Voix humaine, opéra représenté à Garnier en décembre 2015, un immense écran en fond de scène levait l’image du théâtre : la salle de l’opéra Garnier. Le public qui remplissait les gradins ce soir-là contemplait quelques minutes, pendant l’ouverture de l’œuvre de Béla Bartók le lieu même où il est, mais vidé — à nu, écorché, à vif. Ce que Warlikowski désigne, c’est ce pli de l’œuvre théâtrale. Le spectacle s’adosse à l’image spectaculaire des conditions de sa représentation, mais loin de faire signe vers une méta-théâtralité qui refermerait le théâtre sur lui-même, il lève l’enjeu même de cette soirée. Cet enjeu est celui de l’adresse. Ce théâtre regarde ceux-là qui regardent, nos propres fantômes, et ce qui est contenu dans la salle quand nous ne sommes pas là, ce qui persiste encore. Surtout, au moment où nous regardons l’écran, l’absence nous dévisage. Ces autres, les spectateurs anciens nous regardent depuis leur absence.
Théâtre politique en ce qu’il ferait politiquement du théâtre : l’espace d’une confrontation. Ce sera d’ailleurs l’enjeu du spectacle : celle de l’homme et de la femme, c’est-à-dire dans cette lutte, celle de la femme contre l’homme, et sa lente et violente tension vers l’émancipation. Et les écrans lèveront une image insistante de l’enfance en noir et blanc, mais dont le sang se répand en rouge vif : image sans rapport avec la fiction, sauf à la voir comme une image intérieure d’un devenir arrêté, et qui cherche cependant à avoir lieu – comme s’il s’agissait d’échapper tout à la fois à être femme ou homme, et dans le conte cruel et terrible, à devenir enfant, quand bien même cela passe par un sacrifice.
L’image théâtrale – spectaculaire, des conditions de la représentation sur le plateau lui-même – était encore visible sur la scène de l’Archevêché l’été 2016 à Aix-en-Provence, pour sa création du Triomphe du temps et de la désillusion (Il trionfo del Tempo e del Disinganno) [17] . Cet opéra de Georg Friedrich Händel dont le livret est édifiant et, à bien des égards abject, fut l’œuvre de Benedetto Pamphylie qui voulait éduquer les jeunes filles dans le sens d’une certaine histoire. Il fallait apprendre aux femmes à se soumettre parce qu’elles ne possèderaient que leur beauté pour elles, une beauté éphémère et trompeuse, alors que la vérité se trouve au ciel, et dans la mort qui est la seule consolation. L’enjeu de l’adaptation de Warlikowski tient à dialectiser le récit du cardinal pour lui faire dire le contraire, dans ses propres mots, et dans le lieu même du pouvoir religieux, totalitaire et mortifère.
Warlikowski transforme la scène en salle de cinéma où des jeunes filles de Varsovie vont, la soirée durant, prendre place pour observer le drame qui va se dérouler comme pour elles : car c’est pour elles que Pamphylie a écrit le livret, et c’est à leur édification que le spectacle est destiné. Alors elles s’assiéront face à nous, et seront l’écran que nous regarderons, tandis que nous serons l’écran qu’elles regarderont en traversant le drame.
Warlikwoski écrira, ainsi, un contre-drame : une contre-histoire. Au début du spectacle, sur les accords baroques de Händel, l’écran en fond de scène, derrière les gradins de cinéma, projette un court métrage singulier. Des jeunes hommes et femmes d’aujourd’hui dansent dans un club : ils dansent, s’embrassent, boivent, prennent des pilules et du plaisir. La jeune Beauté (c’est son nom) danse au milieu des jeunes de son âge, et s’écroule soudain, avec un garçon. L’overdose sera fatale à ce dernier, mais Beauté est conduite à l’hôpital à temps. L’opéra s’ouvre alors, et sera l’espace du rituel d’un deuil. Le fantôme de ce garçon ne cessera de revenir sur le plateau. Beauté voudra faire l’expérience de la joie et de la vie, tandis que vont la défier le Temps et la Désillusion (son père et sa mère, dans la fable que dresse ici Warlikowski, qui sait combien le schéma familial est structurant dans la mesure aussi où on peut le détruire). Sur les écrans, derrière les gradins de cinéma, vont et viennent les images d’une jeunesse qui cherche à vivre et à échapper au temps : sur le plateau se raconte l’histoire, et entre les deux, au pli dialectique des écrans et des corps, se lit la tragédie que Warlikowski nous fait lire à rebours de l’écriture baroque. Au milieu, la joliesse de la musique, sa splendeur même qui insulte les corps sacrifiés des jeunes filles. C’est cette insulte que Warlikowski propose : une insulte portée par les écrans qui travestissent le drame, le démontent et le pulvérisent.
L’intermédialité organise une revanche : cette dialectique du théâtre et de l’histoire où ni l’un ni l’autre ne sort indemne, mais où l’un par l’autre est envisagé et dévisagé, et ainsi traversé. Dans cette nouvelle scène warlikowskienne, l’usage plastique de la vidéo permet de construire un théâtre double, doublé ou spectral, tout en l’ancrant au présent de sa performance : le dispositif spectaculaire produit par ce biais un récit contemporain de sa perception : « C’est plus une installation, animée par l’’esprit proustien’, qu’une adaptation », confie Warlikowski à propos de sa dernière création autour d’À la recherche du temps perdu, intitulé symptomatiquement Francuzi (Les Français) [18] . « On ne peut pas transposer au théâtre quelque chose qui, à l’époque, avait déjà dépassé l’idée même du roman [19]] ». Dépasser l’idée de théâtre par le théâtre lui-même, par ce qui l’interroge et le dévisage, le regarde et l’enregistre, le projette littéralement, c’est aussi l’ambition désormais de Warlikowski : tenter de repenser l’usage du récit de notre temps par l’archi-récit proustien, modèle de tous les récits de la modernité, et qui ne suffit plus. En fond de scène, le même écran immense que pour ces derniers spectacles, et un comptoir de bar à cour. À la fin du spectacle, Charles lâchera, comme une conclusion définitive de son histoire, de cette histoire : « Charles Swann n’est plus… Marie de Guermantes n’est plus… Marcel Proust n’est plus… Thomas Mann n’est plus… Franz Kafka n’est plus… Richard Strauss n’est plus… » Sur l’écran sont passés des vidéos d’un monde disparu lui aussi, images qui nomment ce monde, mais qui le nient radicalement aussi : une société et ses mondanités sont remplacées par une image de forêt dépliée par un long travelling. La vidéo est omniprésente, soit qu’elle redouble ce qui se joue sur la scène (des corps alanguis, intenses, désœuvrés), soit qu’elle fabrique une fiction lointaine qui ne se dévoilera jamais. Les Français sont une image : celle du spectacle qui prend corps dans cet écran levé sur le plateau pour faire signe vers le présent, une société polonaise contemporaine qui s’empare de l’œuvre de Proust pour se nommer. Un Proust homosexuel et juif, un Proust qui serait le contraire de l’image culturellement normée à laquelle on devrait révérence et admiration.
Ce qui n’est plus, c’est le monde policé des sociétés européennes : les masques s’effritent. Proust regarde une société rongée d’antisémitisme, gagné par la fièvre nationaliste, pourrie de l’intérieur par des rapports de classe qui creusent inégalités et ressentiment. Le spectacle de Warlikowski vise à faire tomber ces masques, à rehausser ces parts cachées, à dévoiler les mécanismes d’une machine à l’œuvre aujourd’hui sans masque. Ce qui a fini avec le monde de Proust, c’est l’illusion d’une rédemption par l’art. Désormais, l’art ne sauve pas : il sert de tribunal pour livrer les pièces capables d’instruire un procès à l’époque,
L’usage ainsi fait par Warlikowski des dispositifs intermédiés ne paraît à cet égard être technique qu’en apparence : c’est plus généralement parce que l’Histoire fait écran à notre émancipation que les écrans se dressent sur le plateau pour figurer l’ailleurs onirique d’une présence, désirable et impossible qui dessine cependant l’exigence d’un ici et maintenant.
En tout, la scène voudrait inventer les territoires nécessaires où le corps inventerait son identité en lutte contre celle que lui imposent les pouvoirs (politiques et médiatiques) : le corps de l’acteur sur scène et son corps sur les écrans dressent le dialogue d’une autre histoire qui à la fois en finirait avec une certaine histoire, et se donnerait la force d’en recommencer une autre.
Si l’Histoire se raconte toujours par la fin, tout mouvement qui chercherait à s’en émanciper traque dans ses fins des recommencements possibles. Ce serait une loi, un axiome : les règles syntaxique d’une certaine dramaturgie et d’une politique essentielles qui chercheraient à échapper au piège de la tautologie : comment s’affronter au monde, sans le redoubler, le rejouer ? Comment recommencer le monde, sans s’en enfuir ? Sur quoi projeter les images et les formes d’un ailleurs qui sauraient à la fois injurier notre temps et proposer la levée d’un autre, plus désirable, plus émancipateur, plus intense et nécessaire ? Ce qui fait écran au monde est souvent aussi ce qui nous permet de le rejoindre. Quel théâtre aujourd’hui, renouvelant l’héritage de Brecht, saura faire de ces distances la stratégie d’une approche ?
Une tâche s’élabore depuis quelques années qui prend racine dans la certitude qu’un certain monde s’achève et se formule dans un désir : s’ouvrir aux terminaisons nerveuses de notre temps, et dans les fins des formes qu’on inventerait, chercher les corps glorieux, renaissants, de l’Histoire.
