Accueil > RECHERCHES | ARTICLES & COMMUNICATIONS > Maria Vélasco | Partir, ou l’érotique du retour
Maria Vélasco | Partir, ou l’érotique du retour
À propos de Délivre-toi de mes désirs
vendredi 1er décembre 2017
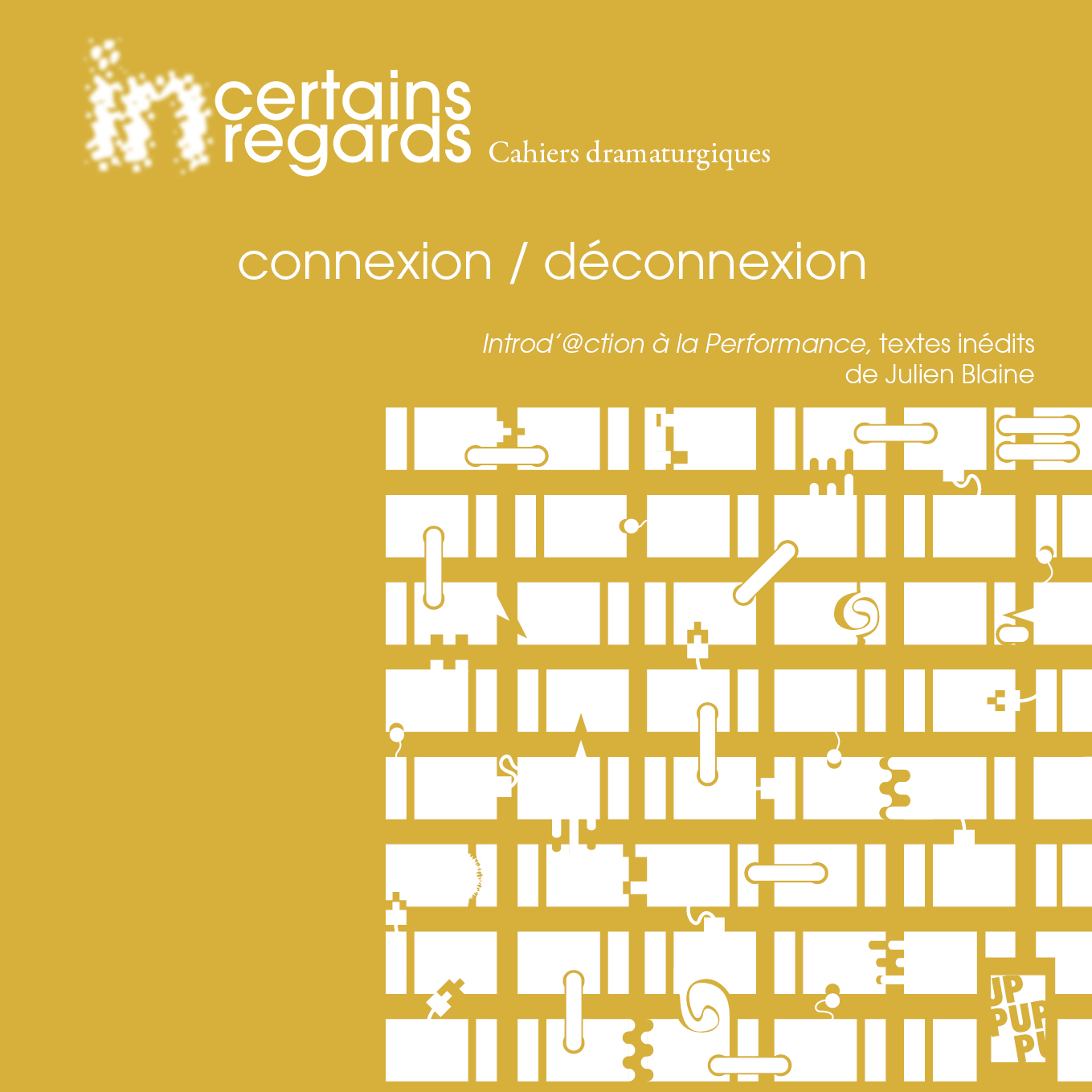
Article paru dans la revue Incertains Regards n°7, « Connexion / Déconnexion »,
Presses universitaires de Provence, – décembre 2017Cette note dramaturgique accompagne la création sonore de la pièce, Délivre-toi de mes désirs de Mario Vélasco, réalisée avec les étudiants de la section théâtre d’Aix-Marseille Université.
La mer est une marelle composée par des déchets blancs et des hommes noirs. Je sèmerai des miettes de pain pour me souvenir du chemin retour. La mer vous secouera, la mer vous engloutira, la mer lavera vos fosses nasales, baisera vos pieds fatigués et vous fera un cunnilingus ! Combien d’hommes doivent encore mourir pour démontrer que la nature s’est trompée ? Elle s’est trompée en nous naissant.
Maria Velasco, « Prologue » [1]La faillite des enchaînements sensori-moteurs fait naître par elle-même un espace déconnecté. Ça ne veut pas dire que les parties soient sans connexion ; ça veut dire que la connexion vient d’ailleurs.
Gilles Deleuze, Vérité et temps, [2]
Fable de la déchirure
Elle s’appelle Maria. Elle a l’âge des désirs et des déchirures, l’âge où les désirs sont des déchirures : partir, c’est tout ce qu’elle désire sans d’autres raisons que ce désir. Et partir, c’est quitter Madrid, ce vieux monde, l’Europe aux anciens parapets, sa famille portant en elle l’histoire tue de l’Espagne fasciste qui par relents remonte à la surface. Oui, laisser tout derrière soi, prendre le large et qu’on n’en parle plus. La pièce s’ouvre sur ce désir de départ – qui ne se fait pas : alors, on parle. C’est le début du théâtre quand le désir échoue sur lui-même, sa peur, son vertige, et qu’on l’échange en parole, que la parole devient l’échange du silence et du désir – ou plus simplement parce que, réalisé, le désir cesserait : et que la parole prend le relai du désir, pour le dire, encore et encore, et son échec qui le recommence.
Maria regarde de l’autre côté du monde où est la vie qui l’attend. Et l’autre côté du monde, de Gibraltar, c’est l’Afrique, là même d’où partent des milliers de réfugiés depuis des années pour échouer ici, où se cristallise l’échec de l’Europe et son projet universaliste devenu les villes citadelles de Ceuta et de Melilla : barbelés, fosses, centre de rétention, plage qui sont des cimetières ou des prisons, et souvent les deux [3].
La pièce s’ouvre donc sur ce chiasme troublant et déchirant : Maria voudrait émigrer en Afrique, « prendre une patera [4] dans l’autre sens », passer la faille qui court le long de notre Histoire, et franchir : « prendre une patera dans le sens contraire » [19]. Cette « faille entre deux plaques tectoniques » [19] de part et d’autre de laquelle les désirs se jouent et s’échangent nomme la jonction du monde à l’endroit de la séparation : du monde et des êtres, et des langues, de la vie et de la mort, du nord et du sud, et de tout ce qui, dans la suture, sépare. Le théâtre naît depuis cet espace de l’entre-deux qui déchire au lieu de la reliance – une déconnexion qui est la condition de la connexion, connexion qui est tendue vers sa déconnexion.
« Pourquoi tu passes ton temps à traverser le détroit de Gibraltar ? » lui demande son père, au premier mot de la pièce. « Pour trouver une histoire. » [15] Le détroit, elle ne le traverse qu’en pensée et en rêve – mais ce rêve prend soudain corps, dans le corps d’un homme. Alors cette histoire qu’elle cherche, elle la trouve à la peau même des choses et d’un homme et c’est une histoire d’amour qui se superpose au lieu même de l’Histoire. Il s’appelle Pap. Il est Sénégalais et vit dans le quartier multiculturel de Lavapiès. Le corps amoureux devient l’espace où éprouver radicalement l’altérité que le désir appelait : voyage qui dès lors ne cessera de se faire et de se défaire, dans les déchirures et les accords qui se disent, se contestent ou se creusent.
La pièce racontera ce voyage initiatique, via la rencontre avec Pap, au creux d’un autre voyage, concret et creusé dans le premier : les deux voyages, symboliques et réels, renvoyant l’un à l’autre leur pouvoir de révélation. Ainsi, puisque l’attente est un leurre, que l’histoire est toujours au présent, Maria fera le trajet inverse de son désir – dans l’autre sens de l’histoire. Plutôt que d’aller de l’autre côté de la Méditerranée, Maria remontera le temps et l’histoire, son histoire, pour transformer le passé en présent : à Burgos où elle a grandi, elle cherchera les traces de son devenir ; ou remontant même avant sa naissance, dans la rencontre de ses parents, les échanges avec le fantôme de sa grand-mère, elle puiserait là les forces de partir encore.
La fable ne dit rien pourtant de ce qui se joue dans chaque tableau, dans chaque dialogue. Et même dans la langue elle-même. C’est que le thème, ou le motif, sont au principe moteur de la pièce : sa force de constitution et d’arrêt. La déchirure qui fonde le regard et la langue, les rapports entre les êtres et leur histoire, les temps et les espaces, ne fait pas que délimiter des frontières : elle dit aussi combien les franchir est une pulsion de vie qui seule importe.
Déchirée, la pièce l’est à chaque instant, et c’est là son processus – un va-et-vient qui connecte et se déconnecte, relie et sépare, recommence sans cesse. Vingt-cinq tableaux assez brefs l’arrêtent et la relancent, l’échouent en quelque sorte comme des vagues échouent sur le récif et renouvellent la terre, la bousculent : à chaque tableau, on est ailleurs, la suture introuvable organise des départs successifs et l’ordre même des tableaux pourraient être aléatoire. Il ne l’est qu’en apparence, car chacun donne secrètement à l’autre sa force de propulsion – le contamine par contraste ou par déplacements. Des scènes semblent se répéter, mais c’est aussi un leurre : les scènes familiales, les scènes d’amour avec Pap, les monologues intérieurs de Maria, les dialogues (avec un policier, une sexologue) sont repris pour mieux désaxer à chaque fois le point initial – on est toujours ailleurs. Et toujours en dehors de la ligne orientée de l’Histoire, celle de la Causalité, de la Fatalité. Ainsi, le début commence après le début : la première scène porte le titre d’ « Avant-Prologue », et le « Prologue » est la scène 2. L’Origine est toujours en avant : ou après. Elle se donne et se choisit. En Afrique par exemple. Dans le corps de Pap. Ou dans celui de la mer. Et dans la profondeur des êtres. La pièce est en effet déchirée d’emblée dans la conscience même de qui parle. Car avant même le début (le pré-début), cette indication de l’autrice :
Délivre-toi de mes désirs pourrait se définir comme la polyphonie vocale d’un seul personnage. En ce sens, la mise en scène peut être envisagée comme un monologue, mais aussi comme une œuvre chorale avec, au minimum, huit comédien(ne)s.
Les énonciations orphelines qui parsèment ce texte ici et là, sont des confessions inavouables, soulignées par la typographie en italique. Théâtre du moi ? Peut- être, mais « Je est un autre » [11]
Voix diffuse et diffractée, elle déchire la conscience au lieu même de sa prétendue unicité : au théâtre, le personnage (la persona) est censé être celui qui parle au nom de lui-même, il est la voix de sa voix. Ici, une choralité qui doute d’elle-même surgit sans jamais prendre parti de s’écrire comme telle, fragmentée ou en lambeaux : elle s’élabore avant tout comme une hypothèse.
Dans l’hypothèse dramaturgique de la déchirure, la pièce invente pour elle seule cette forme inquiète de la dérive entre chaque tableau, en chaque tableau où on ne saura jamais vraiment qui parle, et à qui – et pour qui. L’essentiel ici encore n’est pas dans l’origine donnée de la parole ou du sens, mais de l’intensité confiée à l’instant. Une définition possible du désir dans sa déchirure politique : une hypothèse érotique.
L’hypothèse érotique du politique
C’est là que l’écriture politique de Maria Velasco joue, et se déchire encore – fait de la déchirure l’enjeu politique de nos jours, tant la politique est désormais l’autre nom des déchirures qui nous constituent – déchirures entre individu et communauté, soi-même et autre, solitude et appartenance. L’enjeu politique serait dès lors, entre autres, celui-là : où et comment trouver une émancipation individuelle qui ne prenne pas les formes du néo-libéralisme et son culte de l’individu roi, qui encourage la concurrence de tous contre chacun ? Une réponse possible et douloureuse proposée dans la pièce : l’amour. Douloureuse parce qu’elle y est le contraire d’un accord plein et entier, plutôt l’affrontement irréconciliable : corps à corps qui maintient le désir à l’état de désir ; possible, parce qu’elle fait de l’affrontement un don, un abandon et un accueil. Une guerre civile en somme, sans la guerre et sans la civilité, et toujours inquiète d’être ce qu’elle est : toujours menacée d’être autre chose, qui serait son envers, le corps en pure perte.
Maria : On est en train de baiser ou de faire l’amour ? (…)
Mondialise- moi ou localise-moi. Nationalise-moi, occupe-moi, déploie tes effectifs [… ]
Fais-moi le nettoyage ethnique, fais-moi le jihad. [52]
Drôlerie de ces scènes crues où le vocabulaire militaire – surtout journalistique – devient chant amoureux. Mais une drôlerie qui n’est pas sans profondeur aussi : la guerre commence aux terminaisons du corps. Dans le dialogue amoureux, le corps expose sa nudité jusque dans la racine de son être : on ne se cache pas. On ne dissimule rien de soi ; on est désarmé.
Dès lors, plutôt qu’exposition d’idées, ou description facile et plaquée d’enjeux politiques vécus de seconde main – il est vrai qu’aujourd’hui, le thème de la migration deviendrait presque un genre dramatique à lui seul, tant il envahit les scènes –, l’écriture déplace le lieu où le politique pourrait s’imposer pour se déterritorialiser dans le corps, c’est-à-dire dans le corps à corps. L’écriture de Maria Velasco fait ainsi le choix de poser au corps amoureux les questions politiques de notre temps, et travaille au corps l’expérience amoureuse comme territoire même du politique. « Le monde des amants n’est pas moins vrai que celui de la politique. Il absorbe même la totalité de l’existence, ce que la politique ne peut pas faire », écrivait Georges Bataille.
Le corps est dans la pièce – et dans la langue même – l’enjeu des appartenances et des reconnaissances, des aliénations et des émancipations, des illusions de soi, des désirs de communautés, et des projets impossibles, des appuis pour demain et des armes pour devenir soi-même par l’autre. Espace des tensions aussi, il est le territoire des malentendus. En cela est-il profondément politique : en Pap, Maria choisit un corps à l’opposé du sien précisément pour se consoler de n’être que ce qu’elle est – une intellectuelle précaire, bourgeoise bohème, blanche, issue d’une famille catholique (et sans doute relativement fasciste) de la province espagnole. Avec Pap, Maria voudrait réaliser le transfert politique qu’elle ne parvient pas à accomplir géographiquement.
Maria : Mordre tes tétons s’apparente à un voyage.
Pap : Lécher ton sexe s’apparente à un voyage. [34]
Ainsi, (tout) contre lui, elle franchit l’altérité. Du moins le croit-elle. C’est la tension terrible et joyeuse de la pièce, qui la maintient dans une dynamique vertigineuse, trouble, toujours insituable, précieuse. Car l’autre ne se réduit pas au fantasme qu’on construit de lui. Pap ne cesse de contrevenir à l’image que Maria se fait de lui, et qu’elle désire davantage que lui. Tandis qu’elle le rêve migrant, misérable, malheureux, damné, lui cherche désespérément un iPhone parce qu’ »on ne peut pas vivre sans WhatsApp » [28]. Alors qu’elle le voudrait déconnecter du réel, pur symbole d’un monde qui le refuse, lui cherche à tout prix à se connecter à la pure contemporanéité qu’il fantasme à son tour : et dans ce jeu entre connexion au monde et déconnexion de l’autre, se joue aussi la relation amoureuse – où être avec l’autre, c’est aussi accompagner sa propre solitude, et s’affronter à son rapport au monde, et surtout, mettre à l’épreuve ses idéaux à la mesure de l’autre.
Émancipation sexuelle et scripturaire
Le titre est à cet égard davantage qu’une clé : une porte ouverte sur la tension à l’œuvre. Délivre-toi de mes désirs. Il est issu d’un poème de Mohamed Choukri, écrit en français – mais que l’autrice a lu en espagnol : Líbrate de las cosas hermosas que te deseo. Le traducteur, également éditeur de l’ouvrage, David Ferré, n’ayant pas retrouvé le poème en français, a taché de traduire au plus près la complexité de l’échange et de la demande contenue dans le titre, qu’on peut littéralement traduire par : « libère-toi des belles choses que je désire pour toi. » Ce titre est un programme, une violence. Comment demander à quelqu’un de se libérer ? Et qui plus est, de se libérer de la personne qui l’exige ? Cette violence est aussi un processus : la demande peut porter sur chacun des personnages de la pièce, et peut-être prononcée par tous. Est-ce Maria qui la formule à son amant, ou Pap à Maria – ou le père de Maria à sa fille ? Dès lors, l’injonction devient structurelle : ce qui est appelée ici, c’est à se libérer de toute projection, de tout héritage – à désapprendre tout pour recommencer à apprendre. Ainsi peut se lire, en miroir, la relation du père avec celle de l’amant – et nul hasard sans doute à cet égard si l’amant se nomme Pap – double du Père : et si le sexe est dans la pièce le territoire éparpillé de l’émancipation des origines :
J’étais une enfant très peureuse. J’ai conquis mon courage à coups de machette. Il m’a fallu coucher avec des gitans, des dealers, des ingénieurs prétentieux, des paysans du Rif, des hooligans écossais, des jeunes entrepreneurs plus malins que des singes, des rouquins dépités, des pédés paumés, et même bouffer quelques chattes, pour parvenir à couper le cordon ombilical [94].
Surtout, la relation amoureuse avec Pap rejoue – ou renouvelle – la relation avec le père de Maria (seulement nommé : Père), comme s’il s’agissait non pas tant d’une répétition freudienne sur le mode Œdipien, que d’une lente desinstitution politique, d’une émancipation qui commencerait par la Famille, avant de rejoindre l’Amant, et de se confondre ultimement dans l’écriture :
— Père : Rassure-moi, tu vas pas y aller en patera au moins ?
— Maria : Je prends le ferry papa. La patera, c’est une métaphore.
— Père : C’est quoi une métaphore ?
— Maria : Le théâtre est une métaphore.
— Père : Ma petite, là-bas, la liberté d’expression n’existe pas, sans parler du statut des femmes ! Et après, vous critiquez Franco, mais...
— Maria : J’aime l’Afrique, j’aime les quartiers chaotiques, tout comme les hommes qui me font souffrir.
— Père : Regarde-moi cette flopée de perdrix là-bas !
— Maria : J’ai ta bénédiction ?
— Père : Qu’est-ce que tu veux que je te dise ?
— Maria : Eh bien, ça.
— Père : Et c’est quoi, ça ?
— Maria : Ton texte. […] T’arrives à lire ?
— Père : « Dé-li-vre toi de mes dé-si-rs ». [116-117]
Au cours de cette dernière scène, le dialogue entre Maria et son père se referme sur le geste de l’écriture lui-même, dans une mise en abime qui désigne aussi le processus de composition autant que le trajet qui a conduit à sa mise en pièce. La métathéâtralité referme le texte sur lui-même : et Maria, double spectral (autofictionnel ?) de l’autrice, se tient tout à la fois comme personnage et comme dramaturge. L’héritage familial, la relation amoureuse et l’écriture dramatique se confondent finalement à ce point extrême où le père lit son propre rôle – celui de délivrer sa fille de ses désirs.
Au terme de la pièce, la métathéâtralité se double d’une autre image : celle de la patera, ces embarcations que prennent les migrants pour rejoindre le sud de l’Espagne depuis le Maroc. Et précisément, c’est ce que raconte le poème de Choukri – poète marocain – à l’ouverture de la pièce :
Je n’aurais pas dû dire : / Demain, je partirai. /Il était difficile de partir / Il était difficile de rester. / Et je suis déjà parti. / Et je suis déjà revenu. / C’est ce qui me constitue maintenant. / On a beau s’éloigner l’un de l’autre, / tu m’appartiens et je suis à toi tout autant. [13]
Les lectures amoureuses et politiques se croisent ici encore, se superposent et dessinent des lignes de fuite : et l’exil tend ainsi à se confondre avec la séparation, si celle-ci est une déchirure qui constitue. La déconnexion travaillerait dès lors une connexion autre : aberrante, essentielle.
Ce poème de Choukri nomme également l’utopie de Maria – ce non-lieu, qui est le lieu concret de l’Afrique, saisie comme masse, pure image, ailleurs rimbaldien. Nul hasard si Maria Velasco décrit le déploiement de la dramatis personae et sa tension entre pièce chorale et monologue diffracté sous l’auspice de la formule de Rimbaud : « Je est un autre » – issue de deux lettres, la première datée du 13 mai 1871 à Georges Izambard son professeur, et la seconde, du 15 mai, à Paul Demeny. Dans la première, Rimbaud notait ceci : « C’est faux de dire : je pense : on devrait dire : on me pense » ; dans la seconde, il écrivait : « Si les vieux imbéciles n’avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n’aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini ! ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s’en clamant les auteurs ! » Dans chacune des lettres, la volonté de refonder une anthropologie à rebours : à rebours de la langue et de ce qu’elle a constitué, à rebours des attendus, de la vie elle-même qu’on hérite et qu’il faut fuir. C’est cette contre-vie que cherche Maria, cet à-rebours qu’elle recommence en elle : faire le chemin à l’envers, c’est « prendre une patera dans l’autre sens », « prendre une patera dans le sens contraire » [19].
Fuir ?
Mais en avant. Les médecins disent qu’un voyage est un mouvement statique.
Un voyage est un mouvement statique.
Mais qu’il y a des lieux où l’on ne revient jamais ou bien où l’on revient tout le temps.
Tremper son cul dans la mer.
J’ai droit à un naufrage. [22]
Ce chemin, outre celui de Rimbaud vers l’Abyssine, fut celui de bien d’Occidentaux en perte de repère spirituel et politique. Et de part et d’autre de la Méditerranée, le Maroc et l’Espagne – comme la France et l’Algérie –, ont partagé une histoire commune qui fut celle des déchirures constituantes, des déconnexions qui n’ont pas cessé de les connecter. Ainsi de Mohamed Choukri, ou, dans l’autre sens, d’un auteur espagnol dans la silhouette traverse la pièce, et que Maria nomme dans un de ces monologues dramatiques où la voix est diffusée, éclatée, plurielle, adressée à elle-même, configurée sur la page entre roman et italique.
Je voudrais avoir la mémoire d’un enfant qui découvre le monde en exil.
Seul celui qui n’a pas de patrie aspire à en vouloir une, après, tu peux la balancer aux toilettes.
Je tombe sur Juan Goytisolo à l’hôtel Chellah à Tanger. Et qu’est-ce qu’il me demande ?
Mademoiselle, vous êtes d’où ?
Au diable ! Qu’importe d’où je suis ? Ce qui importe, c’est d’où je viens, et où je vais... Je suis de Burgos. Le Cid, le boudin, la cathédrale, tout ça... L’air des nuits d’été embaume la Castille. Y a-t-il une machine à neige quelque part ? Mais il y règne toujours comme le parfum de l’armoire d’un défunt. Sur les terrains en friche, les promoteurs se White trash. Ordure blanche. Tu sais quelle quantité de papier recycle le prolétariat ? Je ne veux pas gouverner l’Europe. [23]
Né en 1931, Juan Goytisolo fut l’écrivain de la déconnexion espagnole – de la connexion marocaine : des déchirures de la démocratie européenne. Vivant une grande partie de sa vie en exil pour fuir la dictature franquiste et poursuivre son engagement militant communiste, d’abord à Paris à partir de 1956 (lecteur à Gallimard, il fit publier et connaître la génération des auteurs des années 50 et 60, Rafael Sanchez Ferlosio, Carmen Martin Gaite, Ana Maria Matute…), proche de Sartre et de Genet, il vivra entre la France et le Maroc, à Marrakech où il compose ses œuvres majeures, et s’impose comme un intellectuel critique de la civilisation occidentale, marxiste non orthodoxe, penseur inflexible de l’autre – c’est-à-dire, contre lui-même. C’est à Marrakech qu’il trouva la mort, selon la formule – ce jour où j’écris ces lignes, 5 juin 2017.
Le faux dialogue de Maria avec Goytisolo est un pivot dans la pièce : c’est par la question adressée que Maria parvient à se saisir de sa trajectoire : celle qui l’emporte, plutôt que celle qui la détermine. C’était déjà au cœur de la réflexion de Goytisolo [5] : à partir de cette crise spirituelle, se demander que faire politiquement ? Pour accéder à l’altérité, il faudrait d’abord commencer par soi. C’est là que se met en place le mécanisme du miroir : l’Africain Pap, qui est l’étranger, devient le miroir du Père – mais un miroir inversé : l’un du désir, l’autre de la détestation. Car l’altérité n’est pas une valeur en soi. Maria découvre, à chaque réplique de son père, tout ce qui la sépare de lui : et autant que Pap, le Père finit par représenter l’altérité absolue. Élevé dans le culte du dictateur Franco, il n’a rien perdu de ses opinions rétrogrades, néo-machistes et racistes, à l’image de bien de ses contemporains. Finalement, c’est bien l’altérité qu’il représente aux yeux de sa fille. Une altérité qui est pourtant au plus proche d’elle et d’où elle est littéralement issue – là où l’altérité de Pap est celle de l’éloignement. Si tout l’Histoire de l’Occident la pousse à haïr Pap, tous les déterministes sociaux et culturels lui imposent aussi d’aimer son père. Dans ce croisement des amours et des haines, des altérités et des familiarités, rien ne se résout : tout s’agrège autour d’elle sans prendre forme. La quête de sa singularité bute sans cesse sur ces contradictions qui la constituent. Les personnages font face à des surfaces immédiates de l’altérité, et leur attraction ne fait que constamment ébranler les clichés culturels : c’est ici que le théâtre a lieu, s’il a à voir avec le conflit lié à la catastrophe (la rencontre avec l’autre est ce conflit, et cette catastrophe) – jeter les corps les uns contre les autres pour briser les images qu’on a d’eux. Car au-delà de ce qui construit ces êtres, demeure leur corps : le corps érotique de Pap, le corps paternel du Père – et les considérations idéologiques de s’abimer sur ces corps, leur singularité irréductible à toutes constructions théoriques. Tel serait le trajet de Maria : rompre avec Pap au nom du désir ; renouer avec son père malgré l’opposition et au nom d’elle aussi.
Colonisé et être colonisé
Dans ces flux croisés entre érotique et politique charriés par l’histoire de l’Espagne, la relation amoureuse rejoue également les enjeux de domination de la colonisation.
Va te faire foutre.
Comme tu voudras, mais avec une capote. Et oublie l’idée de prendre une patera.
Pour tout désapprendre. […] Pour me débarrasser des préjugés. Me remplir de préjugés. Coloniser et être colonisée. [21-22]
Ce que raconte la pièce, ce dont elle témoigne, c’est que dans toute forme de relation, il y a une forme de domination et de soumission – et quand la relation est plus intime, cette forme de domination est plus accentuée. Maria chercherait désespérément à échapper à ces enjeux de domination – aller à la rencontre de l’autre sans le coloniser, sans prétendre l’aider avec l’idée que ses propres valeurs valent mieux que les siennes. Cet enjeu qui traverse toutes les scènes avec Pap, et qui hantent les monologues – ses souvenirs, ses tensions, ses peurs (notamment avec la sexologue voilée, qui lui pose crument des questions sur sa sexualité et contrevient à ses préjugés sur les femmes voilées, forcément à ses yeux dominés) –, traverse l’histoire de l’Espagne et de son héritage colonial. Cette histoire s’est toujours réalisée sous l’autorité bienveillante de la puissance qui se donne comme mission d’aider. Dans la littérature espagnole, c’est davantage le continent américain qui a été l’objet de fiction et des confrontations avec l’histoire – autour du pivot de 1492, à la fois découverte des Amériques et conquête de Grenade qui aura pour conséquence l’expulsion des Arabes, présents sur le sol espagnol depuis sept siècles (ce qui fait de ce conflit, une guerre civile). Il est plus rare que des écrivains espagnols questionnent les relations avec l’Afrique du Nord. Et encore plus, en les situant sur le territoire de l’érotique. Et pourtant, c’est bien l’enjeu premier de cette Histoire : ce que l’Église Catholique d’Espagne a interdit en premier lieu, ce sont les hammams. Le corps – son éventuel érotisme – est l’espace premier de la reconquête idéologique, la reconquista. Ce sont les hammams (et les cinémas érotiques) dont Maria en retour refait la contre-conquête : pendant la guerre civile, et sous le Franquisme, le corps a été attaqué et censuré, mais ce fut paradoxalement l’occasion d’une redécouverte de ce corps, territoire d’exploration d’autant plus vif qu’il était un tabou, un interdit sacré. Ainsi, quand Maria se souvient de sa première émotion érotique, éprouvée dans un cinéma avec Mohamed , le souvenir de la rencontre de ses parents se superpose. Maria fantasme : peut-être était-ce même cinéma où se sont embrassés ses parents ? Et nul hasard si c’était devant Mogambo, de John Ford, qui raconte les relations orageuses de couples venus d’Amérique au Kenya – et dont les scènes d’amour furent largement censurées en Espagne, jusqu’à brouiller l’intrigue. La logique du sens était alors remplacée par la logique des sens – et les violences politiques et religieuses sont retournées au lieu même de leur interdit.
Dans n’importe quelle boutique de Jemaa el-Fna ou d’Outa el Hamman, le manque d’hygiène est compensé par le plaisir des sens. Aller dans le Sud pour récupérer le Nord. « Mon royaume n’est pas de ce monde », Jean ; « Le Royaume des cieux est parmi vous », Lucas ; « Le ciel est en-dessous. » [20]
Les références à la religion catholique sont légion dans la pièce, et toujours dans le sens de cette perversion : le cinéma où elle se rend (et éprouve sa première émotion sexuelle) s’appelle ainsi l’Éden ; lorsque le père surprend Maria et Pap au lit, il ne perçoit rien, trop bouleversé par la rencontre de deux serpents dressés en train de copuler devant lui [36] ; et cette image biblique de la genèse ne cessera de revenir – jusque dans un titre : La chance Adam et Ève de ne pas avoir d’aïeux [43]. Et tout au long de la pièce, les relations avec sa famille ne sont qu’une longue conversation autour des croyances respectives des uns et des autres.
Maria : Grand-mère, tu crois en la Bible toi ?
Grand-Mère : Oui, grâce à Dieu ma petite.
Maria : Adam et Ève étaient Noirs.
Grand-Mère : Mais qu’est-ce que tu racontes ? Dieu a créé l’homme à son image et Dieu n’est pas Noir. [31] [6]
La domination se joue ici dans l’aveuglement absolu de l’altérité : « un bourgeois est quelqu’un qui est incapable de se représenter l’autre », écrivait Barthes : le néo-colonialisme est ignorant de lui-même, s’énonce avec la parfaite innocence du bon sens, du sens de ce qui est bon, face à ce qui est mal – ce qui est inconnu. C’est ce lent arrachement, ce dessaisissement des héritages culturels, et quasi métaphysique que traverse Maria pour prendre possession d’une physique qui lui serait propre.
L’histoire est à réinventer
Pièce de l’altérité jusque dans ses contradictions, ses limites, ses obstacles, ses illusions, Délivre-toi de mes désirs est une pièce de circonstance, au sens le plus haut. Elle se saisit de notre histoire – les naufrages de migrants à Ceuta et Melilla, les violences urbaines au sein des quartiers multiculturels, les engagements humanistes qui cachent parfois des relents de bonne conscience eurocentrée finissant par assigner de nouveau chacun à ses positions de dominés / dominants –, et refuse le surplomb de la leçon, de la thèse, ou de la résolution. En posant l’enjeu politique sur les corps et les affects, elle libère justement le désir de sa charge purement amoureuse pour en faire la question sensible de notre temps. Si l’amour est à réinventer, disait Rimbaud, c’est aussi à l’aune de notre Histoire, dans sa capacité à réinventer cette Histoire.
Au terme de la pièce, Maria aura rompu avec Pap et renoué avec son père : sans rien trahir ni sans rien renier. Au pied du Père, un oiseau tombe, mort sans doute. Il le prend dans ses bras et le lance dans les airs, il retombe. La nécessité de l’émancipation ne doit pas aveugler sur sa violence, ou ses échecs.
À la suite du poème de Choukri, Maria Velasco a choisi de placer en épigramme, un extrait de Robinson Crusoé, de Daniel Defoe – que la mère lira à sa fille, au cœur de la pièce. Robinson, attiré vers l’ailleurs des mers, échoué loin des civilisations, et qui recommença avec Vendredi l’épreuve de l’autre – de ses désirs et de ses incompréhensions.
Maria : Tu sais ce que ça veut dire quand un personnage n’a pas de nom à lui ? Qu’il n’a aucune entité. (...) On se pénètre maladivement...
Pap : Pourquoi t’es si obsédée ?
Maria : Parce que nous sommes impénétrables. Ma tête, c’est l’Europe, et mon sexe le Rocher de Gibraltar. Je suis sûre que Crusoé culbutait Vendredi, ou l’inverse. J’imagine mes mots blancs glisser sur ton corps noir comme la mousse sous la douche. […] Tu m’as colonisée avec ton sperme et moi, je te colonise avec mon langage. [105]
Pièce des colonisations et ces impénétrables, sur ce qui relie et rompt, ce qui connecte les êtres dans leur déconnexion même, Délivre-toi de mes désirs travaille les tensions des êtres jusqu’au point où se déchirent en eux certitudes et illusions pour l’ouverture d’horizons inconnus – dans une langue qui ne cesse jamais de vouloir nommer les territoires qu’elle rejoint.
